Par: Cynthia Macdonald
22 Mai, 2019
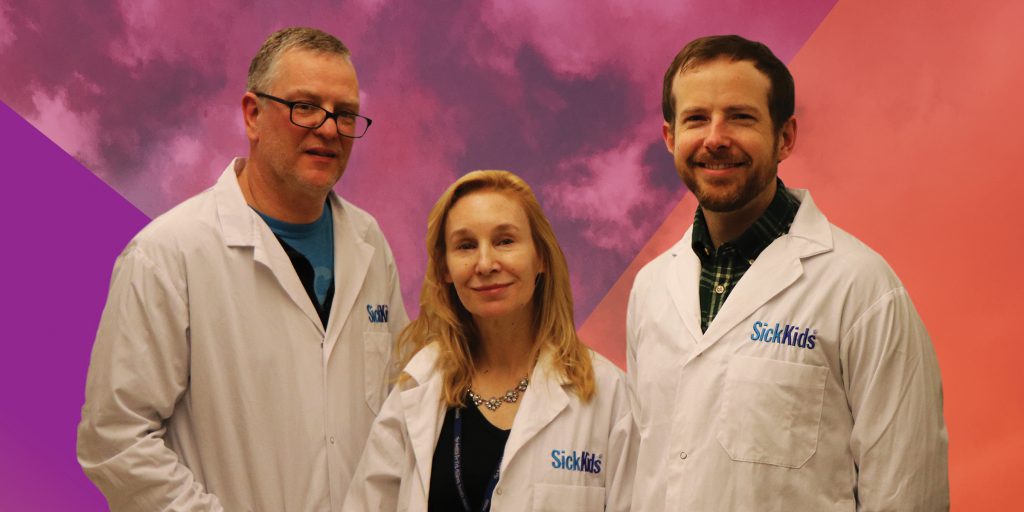
Si seulement on pouvait inventer quelque chose qui conserve un souvenir dans un flacon, comme un parfum, et qui ne s’évapore, ne s’affadisse jamais. Quand on en aurait envie, on pourrait déboucher le flacon et on revivrait l’instant passé.
— Daphne Du Maurier, Rebecca
La mémoire est à la fois notre bien le plus précieux et notre pire ennemi. Peu importe l’étape de la vie, elle peut être éphémère, peu fiable, douloureuse ou absente. Voilà pourquoi, à l’instar du narrateur mélancolique de Du Maurier, beaucoup d’entre nous pourraient souhaiter que les souvenirs vivent à l’extérieur de nous : nous pourrions alors choisir leur devenir, sauver les meilleurs et jeter les autres à la poubelle.
Pour les Boursiers du CIFAR Sheena Josselyn et Paul Frankland, ce genre de mécanisme de contrôle existe déjà. Dans leur laboratoire intégré, au Centre Peter Gilgan de Toronto (qui fait partie de l’Hôpital pour enfants malades), les neuroscientifiques mariés ont réussi à implanter et à rehausser des souvenirs chez des sujets rongeurs, et à les éliminer. Grâce à de nouveaux outils, ils sont maintenant capables d’observer des groupes de neurones qui représentent des souvenirs uniques. De plus, ils ont réussi à éliminer des souvenirs terrifiants et à obtenir des données importantes pour la lutte contre la maladie d’Alzheimer.
La mémoire est en effet un territoire mystérieux, et malgré tous leurs progrès, Josselyn et Frankland admettent qu’elle est encore un peu comme une boîte noire. Il faudra plusieurs années avant de pouvoir appliquer ces résultats aux humains, bien qu’avec le temps cette boîte noire gagne en transparence. Selon Josselyn, avant de pouvoir traiter de graves troubles de la mémoire, « il nous faudra comprendre comment le cerveau fonctionne sur le plan le plus fondamental. Sinon, il nous sera impossible de passer aux traitements cliniques. »
L’étude de la mémoire remonte à des milliers d’années, mais il a fallu attendre le XXe siècle pour que quelqu’un songe à en chercher une trace physique dans le cerveau. Lors de ses études de premier cycle en psychologie à l’Université Queen’s, Josselyn a entendu parler de Karl Lashley. À partir des années 1920, ce scientifique américain a passé de nombreuses années à chercher en vain l’engramme — une structure neuronale insaisissable qui pourrait prétendument héberger une trace mémorielle dans le cerveau. À l’aide d’outils rudimentaires (semblables à des fers à souder), avant-gardistes à l’époque, Lashley a créé des lésions cérébrales chez les rongeurs. Il a ensuite observé ces rongeurs pour voir s’ils oublieraient comment naviguer dans les labyrinthes qu’ils avaient appris à maîtriser.
En fin de compte, Lashley n’a jamais trouvé son engramme magique, mais ses recherches ont néanmoins révélé beaucoup de choses sur le cerveau (comme le fait que la mémoire n’est pas sauvegardée dans un seul endroit, mais dans plusieurs) et ont laissé une marque sur Josselyn. Après l’obtention de son doctorat en psychologie, elle a fait du travail clinique avec des délinquants sexuels en prison. Le travail était intéressant, mais quelque peu machinal et ne correspondait pas à ses attentes. Elle souhaitait faire de nouvelles découvertes et la mémoire était le domaine qui l’intéressait au plus haut point.
« Cette question me semblait des plus fondamentales », dit la Boursière principale au sein du programme Cerveau, esprit et conscience du CIFAR. Encore ravie de son choix vingt ans plus tard, elle dit : « Nous sommes la somme totale de nos souvenirs, voilà vraiment qui nous sommes. Il s’agit de l’essence de notre humanité. »
À l’ère moderne, Josselyn s’est dit qu’elle pourrait réussir là où Lashley a échoué. « Il est quelque peu oublié maintenant, car il n’a pas trouvé ce qu’il cherchait et que ses outils étaient très grossiers », dit-elle. « Mais il avait vraiment de grandes idées. Dans ma carrière, j’ai donc tenté d’exploiter de nouvelles techniques pour répondre à des questions insolubles par le passé. »
Aujourd’hui, au cœur de ce que Josselyn appelle une « période de renaissance » en neuroscience, l’un des outils auxquels les neuroscientifiques ont recours sont les vecteurs viraux. Grâce à cette méthode, les scientifiques réinventent les virus pour exprimer des gènes d’intérêt (plutôt que des gènes viraux). De cette façon, des neurones profonds dans le cerveau peuvent surexprimer un facteur de transcription appelé CREB qui a été lié à la mémoire.
Pendant ses travaux postdoctoraux avec Mike Davis, à l’Université Yale, et avec Alcino Silva, à l’Université de la Californie à Los Angeles, Josselyn a démontré qu’une augmentation de la concentration de CREB dans un petit nombre de neurones profonds dans le cerveau de souris renforçait la mémoire de la peur : une forme mémorielle facile à étudier, en raison de sa grande puissance. L’évolution nous a programmés pour éviter le danger; les enfants auront peut-être besoin de répéter leurs tables de multiplication plusieurs fois avant de s’en souvenir, mais ils se souviendront facilement d’avoir mis la main sur un poêle brûlant. Les souvenirs émotionnels de ce type sont entreposés dans l’amygdale, une structure en amande située en profondeur dans le lobe temporal.
Dans le cadre de ces expériences, les souris ont reçu un petit choc à la patte, associé à un son. « Le choc à la patte ne suffit pas à les blesser, mais il est assez fort pour leur faire peur », dit Josselyn. Le choc a provoqué une réaction d’immobilisation caractéristique. Le CREB a facilement renforcé la mémoire des souris : quand les souris ont entendu le son seul, elles se sont instantanément immobilisées de peur du choc dont elles se souvenaient.
Une autre découverte importante? Il était maintenant possible de voir ces souvenirs améliorés.
« Pour la première fois, nous pouvions vraiment observer le comportement des cellules », dit Josselyn. « Certaines cellules semblaient être recrutées plus que d’autres : celles qui constituaient l’engramme de ce souvenir, et non les autres cellules qui représentaient des choses que les souris avaient apprises avant ou après la manipulation destinée à augmenter la concentration de CREB. » Nous avions finalement découvert l’engramme de Lashley. Plus tard, Josselyn a confirmé ces résultats à l’Hôpital pour enfants malades quand elle a réussi à supprimer un certain souvenir de peur en éliminant les neurones qui le représentaient.
Ajouter des souvenirs. Supprimer des souvenirs. Si l’humanité pouvait avoir recours à ce type de modification cérébrale, s’agirait-il d’un fléau ou d’une bénédiction? La réponse est compliquée. D’une part, si certains souvenirs sont suffisamment horribles pour miner notre qualité de vie, le bien-fondé de leur élimination est évident. D’autre part, il y a une bonne raison pour laquelle nous nous souvenons plus clairement des événements horribles que des événements agréables : pour nous arrêter de faire les mauvais choix qui ont peut-être mené à ces événements.
Quant à l’amélioration de la mémoire, il ne peut y avoir que du bon, n’est-ce pas? Un article populaire de 2017 coécrit par Paul Frankland suggère que la réponse n’est pas si facile.
Le bureau de Frankland est juste à côté de celui de Josselyn. Tout comme son épouse, il est titulaire d’un doctorat en psychologie. Les deux chercheurs se sont rencontrés à la fin de leur doctorat et se complètent parfaitement l’un l’autre. Josselyn, originaire de Cleveland, est bavarde et drôle, tandis que Frankland, originaire d’Angleterre, parle avec courtoisie et réserve. Ils ont tous deux évidemment une très bonne mémoire. Elle se souvient de toutes les paroles des chansons de Madonna qu’elle a entendues et il est une encyclopédie ambulante pour ce qui est des statistiques sur le football.
Frankland s’intéresse depuis longtemps à la neurogenèse, un terme qui désigne la formation de nouvelles cellules nerveuses dans l’hippocampe du cerveau (elle se produit aussi dans le bulbe olfactif). Il y a moins de 100 ans, la neurogenèse chez l’adulte était jugée impossible. Encore aujourd’hui, certains neuroscientifiques doutent qu’elle se produise naturellement chez l’humain adulte.
Frankland n’est pas de ceux-là. Il y a deux ans, il a publié avec le Boursier du CIFAR Blake Richards une recension des écrits dans Neuron qui porte le titre dalinien « The Persistence and Transience of Memory ». La presse populaire en a beaucoup parlé et la plupart des articles portaient un titre qui exprimait l’idée que d’oublier nous rend plus intelligents.
Cette recension des écrits a fait référence à des travaux du laboratoire de Frankland qui ont démontré qu’à mesure que de nouveaux neurones se forment dans l’hippocampe, les circuits existants sont remodelés. Ce processus écrase les vieux souvenirs, ce qui les rend plus difficiles d’accès. Toutefois, selon Frankland, ce phénomène n’est pas nécessairement une mauvaise chose.
Nous sommes la somme totale de nos souvenirs, voilà vraiment qui nous sommes. Il s’agit de l’essence de notre humanité.
« Certains types d’oublis sont bénéfiques », affirme le Boursier du programme Développement du cerveau et de l’enfant du CIFAR. « Le monde change tout le temps, vous n’avez donc pas besoin d’informations vieilles d’une semaine, d’un mois ou de deux ans. Cette information est maintenant inutile. » Frankland ajoute que de toute façon, les gens ne voudraient pas se souvenir parfaitement des événements, car la prochaine fois ils s’attendraient à ce que les événements soient identiques et cela serait déroutant.
Son coauteur, Blake Richards, donne un exemple pour illustrer la question. « Imaginez qu’à votre boulot il y a un stagiaire nommé Matt qui part après son stage. L’année suivante, un stagiaire nommé Mike commence son propre stage. Si votre cerveau se souvient du prénom « Matt » de façon permanente, chaque fois que vous voudrez parler à Mike, vous allez l’appeler Matt. Une solution plus simple est d’oublier le nom de Matt — à quoi bon l’entreposer si vous ne travaillez plus avec lui? Alors vous aurez plus de chances d’appeler Mike par son nom. »
En d’autres termes, une bonne mémoire n’est pas nécessairement celle qui déborde d’information, mais plutôt celle qui sélectionne les informations les plus utiles. Comment procède-t-elle? En effaçant les données qui ne sont plus pertinentes.
Les adultes le font régulièrement et il semble que les enfants le font encore mieux. La question de l’amnésie infantile, un terme créé par Sigmund Freud, est un des domaines de recherche principaux du laboratoire de Frankland. La plupart d’entre nous n’ont aucun souvenir de la vie avant l’âge de trois ans, et ont très peu de souvenirs des choses qui se sont produites avant l’âge de sept ans. Et pourtant, les jeunes enfants se souviennent bien mieux des détails de leurs expériences que les adultes. Frankland voulait savoir pourquoi.
Pour ce faire, il s’est inspiré de Charlotte, 10 ans, la fille qu’il a avec Josselyn. Un jour, il y a environ sept ans, la famille était au zoo de Bowmanville. Après avoir été effrayée par un canard bruyant près de l’étang, Charlotte fut secourue par son père inquiet qui l’a prise dans ses bras et amenée voir un animal plus gentil.
« Pendant des mois, elle a raconté aux gens ce qui lui était arrivé au zoo », dit Frankland. « Puis un jour, le souvenir avait complètement disparu. Elle ne se souvenait plus de rien. »
Il y a plusieurs années, Frankland a dirigé une équipe qui cherchait à expliquer ce phénomène. Les chercheurs ont découvert que chez les jeunes souris, la neurogenèse dans la région de l’hippocampe se fait à un rythme beaucoup plus élevé que chez les adultes, ce qui les rend plus aptes à encoder les détails de leurs expériences, mais aussi à les oublier plus rapidement.
Mais il reste à savoir si les souvenirs disparus ont vraiment été effacés ou bien s’ils sont difficiles à retrouver. La plus récente expérience de Frankland vient soutenir cette dernière théorie. Il a d’abord étiqueté des groupes de neurones représentant des souvenirs de lieux que les souris semblaient avoir oubliés. Quelques semaines plus tard, il a stimulé ces mêmes groupes de neurones. Comme par magie, les souris ont de nouveau reconnu les lieux oubliés. Toutefois, leur rétablissement était incomplet, ce qui laisse croire que l’expérience n’a pas été parfaitement conservée.
« Nous le savons par notre propre expérience », dit Frankland. « Même les souvenirs très importants ne sont pas aussi détaillés et précis que nous l’imaginons. Quand Sheena et moi nous sommes mariés, ou quand notre fille est née — j’ai une idée de la façon dont ces journées se sont passées et de ce que j’ai ressenti. Mais je ne me souviens pas de ces événements avec la même précision que le souvenir du vaccin antigrippal que j’ai reçu ce matin. »
Ajouter des souvenirs. Supprimer des souvenirs. Si l’humanité pouvait avoir recours à ce type de modification cérébrale, s’agirait-il d’un fléau ou d’une bénédiction?
Néanmoins, quand nous nous remémorons des souvenirs à répétition, les connexions synaptiques qui les représentent sont renforcées. Cela peut expliquer le cas de personnes comme Jill Price, une hypermnésique sur laquelle on a beaucoup écrit et qui se souvient intentionnellement (et de façon obsessionnelle) de la plupart des journées de sa vie dans les moindres détails. Mais la plupart des gens ne sont pas comme Price, car ils sont trop occupés à vivre dans le moment présent. Ils préfèrent créer de nouveaux souvenirs et sacrifier les anciens, au lieu de revivre le passé en boucle.
Une grande partie des connaissances sur la mémoire provient de recherches réalisées avec des espèces animales modèles, comme l’escargot, le poisson-zèbre et la souris. Pouvons-nous extrapoler à l’humain ces découvertes extraordinaires réalisées par les neuroscientifiques sur des animaux? Il y a de très bonnes raisons de le croire. L’ère du séquençage génomique a permis de révéler de plus grandes similitudes entre la souris et l’humain, par exemple, que ce qu’on croyait auparavant. Cette ère a aussi donné lieu à la modification génétique, une autre voie possible de découvertes et de solutions curatives. Les êtres humains partagent des voies biologiques clés avec un vaste éventail d’êtres vivants.
Mais il y a bien sûr des différences structurelles importantes entre le cerveau animal et le cerveau humain. « La différence semble résider dans la façon dont sont établies les connexions », dit Josselyn. « Nous avons réussi à comprendre la maladie d’Alzheimer chez la souris, mais jamais chez l’être humain. »
Oui, c’est vrai. En 2017, en collaboration avec Frankland, elle a stimulé la neurogenèse dans l’hippocampe de souris âgées et jeunes qui portaient des mutations génétiques associées à la maladie d’Alzheimer, avec des résultats très prometteurs. Au début, les deux groupes présentaient des plaques cérébrales caractéristiques de la maladie, ainsi que des difficultés de mémoire évidentes. Mais après la stimulation, la mémoire s’est améliorée, peu importe l’âge, et les plaques ont diminué. Peut-on répéter la chose chez l’humain? Pas encore. « Il y a quelque chose qui nous échappe », dit Josselyn. « Et c’est encore un peu difficile de comprendre précisément de quoi il s’agit. »
Et pourtant, comme le souligne Blake Richards, l’étude d’un cerveau qui n’est même pas en vie peut quand même révéler des données précieuses sur le fonctionnement de la mémoire.
Richards est Boursier au sein du programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR. Dans son parcours professionnel, c’est l’intelligence artificielle plutôt que la psychologie qui l’a mené à la neuroscience. En tant qu’étudiant dans le laboratoire de Geoffrey Hinton, Membre distingué du CIFAR, il s’est découvert une passion pour les réseaux neuronaux : des agents d’apprentissage automatique qui imitent les processus du cerveau humain.
« La raison pour laquelle j’ai souhaité étudier la mémoire », dit-il, « c’est que lorsqu’on tente de concevoir un agent d’IA et de le faire interagir avec le monde, on découvre rapidement qu’il faut de la mémoire. Sans apprentissage et sans mémoire, il est absolument impossible de faire faire à un ordinateur le genre de tâches qu’on souhaite qu’il fasse. »
Le cerveau humain compte cent milliards de neurones, reliés par 100 billions de synapses. Il est également alimenté par un élixir chimique de neurotransmetteurs, de peptides et de lipides. Évidemment, le cerveau d’un robot est dénué de tous ces éléments et constitue une structure beaucoup plus simple. Mais il est néanmoins confronté à des défis fonctionnels similaires.
« Si vous concevez une solution basée sur l’IA pour la conduite automobile ou la gestion de comptes personnels, cette solution n’aura absolument aucun rapport avec l’être humain sur le plan chimique. Mais en ce qui concerne certains détails mathématiques, il pourrait y avoir des similitudes », dit M. Richards. Tout comme les humains, les réseaux neuronaux peuvent aussi éprouver des problèmes de mémoire si leur entrepôt de souvenirs inutiles n’est pas purgé — un phénomène appelé surajustement.
Il manque actuellement aux réseaux neuronaux de nombreux détails chimiques et cellulaires du cerveau humain, car la présence de tels éléments complexes pourrait nuire à la capacité des scientifiques d’entraîner ces réseaux neuronaux à l’aide de l’analyse mathématique. Toutefois, Richards conçoit actuellement des modèles computationnels de cerveaux artificiels qui ressemblent plus que jamais à des cerveaux. Selon lui, cela pourrait mener à une meilleure conception de médicaments contre la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies, ainsi qu’à une meilleure compréhension générale du fonctionnement du cerveau.
« Nous pourrions perturber des éléments du modèle pour faire des prédictions sur l’impact que cela aurait sur les capacités mémorielles du système », dit-il. « Vous pouvez y voir une méthode qui ressemble à ce qui se fait avec les modèles climatiques, car le climat est un autre système interconnecté d’une incroyable complexité. »
Richards, Frankland et Josselyn ont tous collaboré à l’étude de la mémoire — Richards a fait un stage postdoctoral dans le laboratoire de Frankland. Leurs intérêts distincts concordent et divergent, mais tous s’entendent pour dire que l’étude de ce concept sous des angles différents permet d’avoir une vision plus riche des problèmes qu’il pose. Voilà pourquoi leur participation à des programmes différents du CIFAR s’est révélée précieuse.
« Travailler au sein du laboratoire de Paul et Sheena m’a été très profitable, car j’ai pu étudier la mémoire dans une toute nouvelle perspective », dit Richards. « Notre capacité à sortir d’un certain schème de pensée et à se concentrer sur quelque chose d’autre est bien plus facile en côtoyant des personnes dotées d’une expertise différente. Voilà pourquoi les programmes du CIFAR constituent un terreau fertile d’où germent de nouvelles idées. »
Les trois neuroscientifiques contribuent collectivement à redéfinir ce que nous entendons par « une bonne mémoire ». Au lieu d’être remplie d’informations facilement récupérables, une bonne mémoire est imparfaite et en changement constant : elle est exempte de données désuètes et s’enrichit seulement par le contenu qui lui sert le mieux. Et si la journée ensoleillée dont vous vous souvenez est pluvieuse dans le souvenir de quelqu’un d’autre, ça va aussi.
Notifications