Reach 2024: Comment le cerveau donne-t-il lieu à l’esprit?
Par Tyler Irving
De l’IA à l’optogénétique, de nouvelles techniques et stratégies permettent aux scientifiques de tirer des connaissances des troubles cognitifs et d’explorer les racines de la conscience
Quelque chose de remarquable vous arrive à chaque instant de votre vie. D’une manière ou d’une autre, environ deux kilos de neurones, de cellules gliales, de protéines et d’autres éléments à l’intérieur de votre crâne produisent les pensées, les émotions, les souvenirs et les actions qui définissent votre identité.
La façon dont la matière physique donne naissance à la conscience – souvent appelée le « problème corps-esprit » – est un mystère de longue date, tant pour la philosophie que pour la science. Il est difficile d’évaluer si nous sommes près de l’élucider, mais il est clair que de nouvelles techniques et stratégies ouvrent la voie à une période particulièrement riche dans le domaine de la recherche sur la conscience.
Ces recherches pourraient nous aider à mieux comprendre les fonctions cognitives et à trouver de nouveaux traitements éventuels des troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence.
« Les outils existent », déclare Adrian Owen, professeur de neuroscience cognitive et d’imagerie aux départements de physiologie et pharmacologie, et de psychologie de l’Université Western.
Il y a dix ans, Owen a cofondé le programme Cerveau, esprit et conscience du CIFAR, dont il est toujours l’un des deux coresponsables.
« Aujourd’hui, notre capacité de mesure dépasse de loin notre capacité de compréhension de ces mesures. Nous pouvons produire des images magnifiquement détaillées du cerveau à l’œuvre, en train de faire son travail. Il nous faut maintenant apprendre à interpréter au mieux ces données. »
« Aujourd’hui, notre capacité de mesure dépasse de loin notre capacité de compréhension de ces mesures. Nous pouvons produire des images magnifiquement détaillées du cerveau à l’œuvre, en train de faire son travail. Il nous faut maintenant apprendre à interpréter au mieux ces données. » - Adrian Owen

Photo: Derek O’Donnell
Comment procéder à l’imagerie du cerveau
Il y a un siècle, le psychiatre allemand Hans Berger a mis en place un réseau d’électrodes sur le cuir chevelu pour réaliser le premier enregistrement de l’activité électrique spontanée du cerveau humain. Connue sous le nom d’électroencéphalographie (EEG), cette méthode est encore largement utilisée dans la recherche sur le cerveau.
Une cinquantaine d’années plus tard, une autre technique s’est ajoutée à l’EEG et est devenue tout aussi essentielle dans ce domaine : l’imagerie par résonance magnétique (IRM).
Dans un appareil d’IRM, de puissants champs magnétiques se combinent à des ondes radio pour produire des images détaillées des structures de l’organisme. Une version modifiée, connue sous le nom d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), va encore plus loin en produisant des données en temps réel sur la manière dont le débit sanguin dans le cerveau est en phase avec l’évolution des pensées et des comportements d’un moment à l’autre.
En utilisant le débit sanguin comme indicateur, les neuroscientifiques peuvent déduire quelles régions du cerveau sont les plus actives lorsque les patient·es accomplissent une tâche ou vivent une expérience particulière. Au cours des dernières décennies, ces scientifiques ont constitué des bibliothèques d’images d’EEG et d’IRMf qu’il est possible d’analyser pour mieux comprendre comment l’activité cérébrale donne lieu à la fonction cognitive.
Un exemple bien connu nous vient des recherches d’Owen lui-même. Il y a une quinzaine d’années, son équipe et lui ont utilisé des images d’IRMf pour montrer que certaines personnes en état dit végétatif peuvent réagir à des stimulations externes. Autrement dit, leur conscience subsiste même s’il leur est impossible de la communiquer.
Depuis la publication de leurs travaux, plus de 1300 personnes se trouvant dans des conditions similaires ont été scannées, et environ une sur cinq présentait un certain niveau de conscience.
« Ces travaux ont maintenant essaimé dans de nombreuses autres directions, et je suis très heureux de voir les gens se saisir de cette idée et de l’explorer », déclare-t-il.

Photo: Christopher Brown
« Pendant longtemps, on a pensé que si un enfant présentait un trouble du spectre autistique, il ne fallait pas le mélanger en introduisant trop tôt deux langues différentes. Mais plus récemment, la recherche a révélé que le bilinguisme n’a pas d’effets négatifs à long terme sur la fonction cognitive. » — Lucina Uddin
Suivi du développement neuronal et du « sentiment d’identité »
Aujourd’hui, les appareils d’IRMf sont plus accessibles que jamais et servent à explorer un éventail le plus en plus large de questions de recherche.
Membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli au sein du programme Cerveau, esprit et conscience, Lucina Uddin étudie les liens entre l’activité cérébrale et la cognition dans le cadre d’un développement typique ou atypique. Par exemple, Uddin et son équipe ont eu recours à l’IRMf pour scanner le cerveau d’enfants âgés de 7 à 12 ans, avec ou sans diagnostic de trouble du spectre autistique.
« Nous constatons que les deux groupes d’enfants mobilisent les mêmes régions cérébrales pour accomplir une tâche donnée », explique Uddin, professeure au département de psychiatrie et de sciences biocomportementales de l’Université de la Californie à Los Angeles.
« Cependant, la séquence et la chronologie des événements pourraient différer d’un groupe à l’autre. En d’autres termes, les deux groupes utilisent des stratégies différentes pour atteindre le même objectif. » Dans une étude à venir, Uddin prévoit de comparer les enfants élevés dans des foyers bilingues à ceux élevés dans des foyers unilingues.
« Pendant longtemps, on a pensé que si un enfant présentait un trouble du spectre autistique, il ne fallait pas le mélanger en introduisant trop tôt deux langues différentes », explique-t-elle.
« Mais plus récemment, la recherche a révélé que le bilinguisme n’a pas d’effets négatifs à long terme sur la fonction cognitive. Au contraire, il peut se révéler bénéfique en aidant les enfants, par exemple, à passer avec souplesse d’une tâche à l’autre. »
La capacité d’outils comme l’EEG et l’IRMf à visualiser les différents mécanismes mentaux utilisés par les patient·es pour accomplir une certaine tâche peut aussi aider à comprendre les conditions qui altèrent la conscience, comme la démence et les lésions cérébrales.

Photo : Bridget Corke
« L’effet était subtil et temporaire, mais cela montre que nous ne sommes pas que des cerveaux ambulants... Nous sommes en relation les uns avec les autres par l’intermédiaire de notre esprit, de nos émotions, mais aussi de notre corps. » - Sahba Besharati
Sahba Besharati, membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli au sein du programme Cerveau, esprit et conscience, se penche sur l’un des mystères les plus persistants de la conscience : le développement de la conscience de soi.
« En tant qu’animaux sociaux, les êtres humains ont un sentiment d’identité très fort qui leur permet d’établir des relations avec les autres », explique Besharati, maître de conférences en neuroscience cognitive au département de psychologie de l’Université de Witwatersrand, à Johannesburg, en Afrique du Sud.
« En cas de trouble cognitif, l’un des défis auxquels les personnes sont confrontées est la perte de ce sentiment d’identité. » Besharati travaille souvent avec des personnes qui ont subi une lésion cérébrale – un accident vasculaire cérébral, par exemple – dont les dommages se situent dans l’hémisphère droit du cerveau.
Certaines de ces personnes souffrent d’un état connu sous le nom d’anosognosie, qui les empêche d’être conscientes de leur propre déficit neurologique. Bien qu’elles soient paralysées du côté gauche, elles peuvent persister à dire qu’elles peuvent tout de même bouger. Elles peuvent également confabuler, c’est-à-dire inventer des histoires pour expliquer leur immobilité.
Dans des travaux antérieurs, Besharati a réalisé une étude où des personnes présentant une inconscience motrice recevaient une rétroaction négative en réponse à une tâche comportementale. À sa surprise, ces personnes ont manifesté une conscience accrue de leur état de paralysie par l’induction d’une émotion négative.
« L’effet était subtil et temporaire, mais cela montre que nous ne sommes pas que des cerveaux ambulants », explique-t-elle.
« Nous sommes en relation les uns avec les autres par l’intermédiaire de notre esprit, de nos émotions, mais aussi de notre corps. »
« D’après nos observations, si nous stimulons les bonnes cellules, nous pouvons faire resurgir le comportement appris... Ces travaux ont changé notre compréhension de certains aspects du codage et du rappel de la mémoire. Les souvenirs ne sont pas perdus, ils sont toujours là... » - Tomás Ryan

Photo : Mark Duggan
Suivi de la mémoire
Un autre mystère inhérent au problème corps-esprit est lié à la manière dont l’information, notamment les souvenirs, est encodée dans la structure physique du cerveau.
À l’instar des scientifiques qui ont utilisé le concept de gènes pour expliquer les caractéristiques héréditaires bien avant le déchiffrement du code génétique de l’ADN, les neuroscientifiques utilisent le terme « engrammes » pour décrire les unités d’information cognitive qui peuvent être stockées, puis consultées et modifiées par la suite.
Bien que nous ne saisissions pas encore pleinement le fondement physique des engrammes, une nouvelle technique connue sous le nom d’optogénétique permet de faire la lumière sur ce problème.
« Depuis une dizaine d’années, nous mettons au point des méthodes nous permettant de marquer des cellules particulières du cerveau qui contribuent à des engrammes spécifiques », explique Tomás Ryan, membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli au sein du programme Développement du cerveau et de l’enfant.
« Par exemple, en exploitant des gènes dont l’expression est une fonction de l’activité neuronale pour exprimer des protéines fluorescentes, nous pouvons voir quand cette cellule modifiée s’active », explique Ryan, professeur agrégé à l’Institut Trinity de neurosciences du Collège Trinity de Dublin, en Irlande.
« Nous pouvons également exprimer des récepteurs optogénétiques qui nous permettent de faire l’inverse : si nous projetons de la lumière sur ces cellules, elles commenceront à émettre des signaux artificiels. »
En recourant à des souris modifiées par optogénétique, Ryan et son équipe peuvent étudier le processus d’oubli, aussi bien celui qui se produit naturellement que des analogues de processus pathologiques non naturels, tels que les lésions cérébrales traumatiques ou la démence.
Une fois que les souris ont oublié un comportement particulier, l’équipe peut stimuler les cellules que l’on sait liées au souvenir d’origine.
« D’après nos observations, si nous stimulons les bonnes cellules, nous pouvons faire resurgir le comportement appris », explique Ryan.
« Ces travaux ont changé notre compréhension de certains aspects du codage et du rappel de la mémoire. Les souvenirs ne sont pas perdus, ils sont toujours là, mais au moment où vous essayez de les récupérer, vous en obtenez un autre que celui souhaité.
Il s’agit d’un déficit de récupération, plutôt que d’un déficit de stockage. »
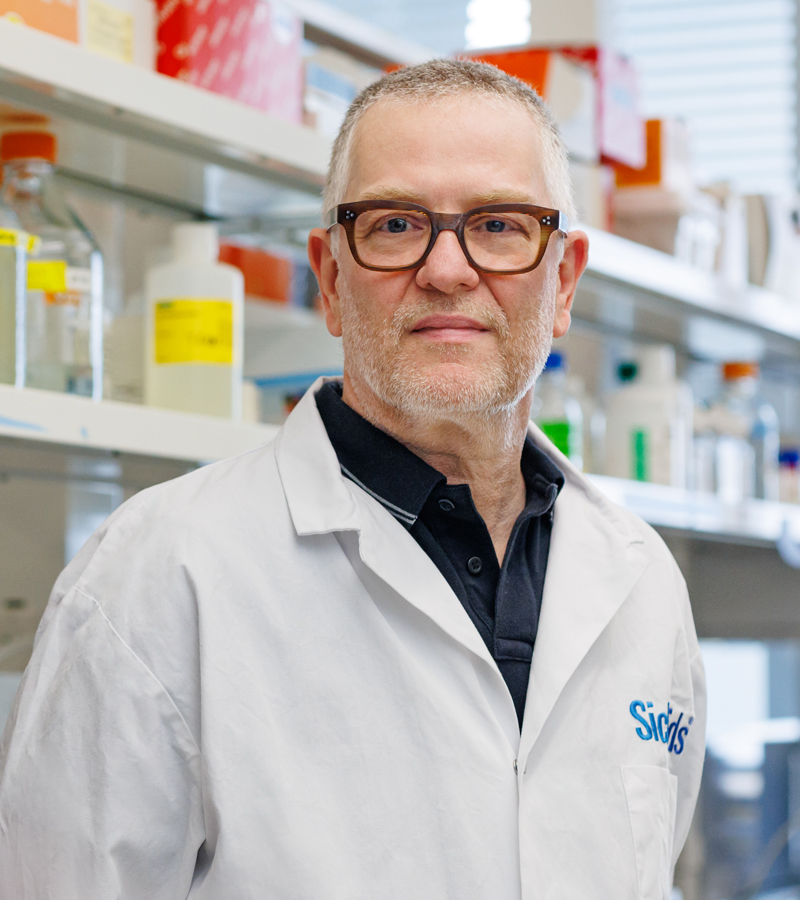
Photo : Josh Fee
« Dans certains troubles cognitifs, il se peut que l’oubli soit insuffisant et
que vous vous retrouviez avec trop de souvenirs actifs qui interfèrent avec le souvenir cible que vous tentez de vous remémorer. Le cerveau n’est pas comme le disque dur d’un ordinateur, il ne se remplit pas. » - Paul Frankland
Paul Frankland, membre du programme Développement du cerveau et de l’enfant et scientifique principal du programme de neurosciences et de santé mentale de l’Institut de recherche SickKids à Toronto, au Canada, a aussi recours à l’optogénétique.
Paul Frankland et son équipe s’intéressent tout particulièrement à un phénomène qui complique notre compréhension du stockage et de la récupération des souvenirs : la neurogenèse, c’est-à-dire la croissance de nouvelles cellules cérébrales.
« On pourrait croire que de nouveaux neurones pourraient encoder de nouveaux souvenirs plus efficacement », déclare Frankland.
« Toutefois, comme vous intégrerez ces nouveaux neurones dans des circuits stables, vous risquez d’annuler des données déjà stockées. »
Cela pourrait expliquer pourquoi les souvenirs créés pendant la petite enfance, la période où la neurogenèse humaine est la plus concentrée, sont parmi les plus difficiles à se remémorer plus tard dans la vie.
Dans des études animales, Frankland et son équipe ont artificiellement augmenté le taux de neurogenèse chez des souris et ont constaté que cela les rendait plus oublieuses.
La mesure dans laquelle les humains continuent à ajouter de nouveaux neurones tout au long de la vie fait encore l’objet de débats parmi les neuroscientifiques et, dans tous les cas, les troubles comme la démence et la maladie d’Alzheimer sont généralement liés à une perte de neurones plutôt qu’à la croissance de nouveaux neurones.
Mais selon Frankland, les nouveaux paradigmes de l’oubli peuvent jeter une lumière précieuse sur les troubles cognitifs et sur la conscience elle-même.
« Il est courant, même parmi les neuroscientifiques, de penser que l’oubli est une mauvaise chose », déclare Frankland.
« Mais on peut facilement imaginer en quoi il peut être bénéfique : si vous essayez de vous souvenir où vous avez garé votre voiture aujourd’hui, il n’est pas utile de vous rappeler où vous l’avez garée la semaine dernière ou le mois dernier. »
« Dans certains troubles cognitifs, il se peut que l’oubli soit insuffisant et que vous vous retrouviez avec trop de souvenirs actifs qui interfèrent avec le souvenir cible que vous tentez de vous remémorer. »
De nouvelles analogies peuvent aussi nous aider à concevoir différemment le rôle que joue l’oubli dans la conscience, explique Ryan. « Le cerveau n’est pas comme le disque dur d’un ordinateur, il ne se remplit pas », explique-t-il.
« Je le vois plutôt comme une sculpture. Il peut y avoir plus ou moins de matière, mais la quantité d’information effectivement encodée est subjective. »
« Au fur et à mesure que nous accumulons de l’information, au fur et à mesure que la sculpture évolue, il ne faut pas se concentrer sur les premières expériences enregistrées. Il faut être capable de généraliser, de donner un sens au monde. À mon avis, cela explique en partie pourquoi nous oublions des détails spécifiques. »
« Quelque 3 milliards de personnes ont reçu l’ordre du gouvernement de limiter leurs interactions sociales pendant des semaines et des mois. Quel est l’effet sur le cerveau de la suppression de ces interactions? » — Danilo Bzdok

Photo : Dominic Blewett
La neuroscience à l’ère des mégadonnées
L’un des outils les plus récents et les plus prometteurs dans l’étude de la conscience n’a rien à voir avec l’imagerie du cerveau ou la manipulation de ses cellules. Il permet plutôt d’analyser la quantité de données sans cesse croissante générée par les méthodes existantes.
« Au cours des cinq à dix dernières années, les neurosciences sont entrées dans l’ère des mégadonnées », explique Danilo Bzdok, titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR à Mila, codirecteur scientifique de l’IVADO et professeur agrégé au département de génie biomédical et à l’École d’informatique de l’Université McGill à Montréal (Canada).
« Nous pouvons désormais créer des ensembles de données extrêmement volumineux d’évaluations cérébrales et d’autres données médicales. Il est difficile d’exploiter ces riches ressources sans recourir à l’apprentissage automatique ou à d’autres formes d’intelligence artificielle. »
En tant que neuroscientifique et informaticien, Bzdok est particulièrement bien placé pour tirer profit de l’intelligence artificielle en vue d’analyser des ensembles de données tout simplement trop volumineux pour permettre un traitement par l’humain, à la recherche de modèles passés inaperçus jusqu’à présent. En fait, bon nombre des ensembles de données utilisés par son équipe et lui-même sont les plus importants jamais constitués.
L’une des découvertes récentes concerne l’étude de l’isolement social, un sujet mis en lumière par les confinements liés à la pandémie de COVID-19.
« Nous avons interprété la COVID-19 comme une expérience naturelle à l’échelle planétaire, explique Bzdok. Quelque 3 milliards de personnes ont reçu l’ordre du gouvernement de limiter leurs interactions sociales pendant des semaines et des mois. Quel est l’effet sur le cerveau de la suppression de ces interactions? »
En analysant les enregistrements cérébraux de 40 000 personnes et d’autres phénotypes de la vie quotidienne, l’équipe a découvert quelque chose de nouveau : un certain nombre de changements dans une région du cerveau appelée le réseau du mode par défaut.
La comparaison du cerveau humain avec celui d’autres animaux suggère que le réseau du mode par défaut est relativement nouveau dans notre histoire évolutive. À ce titre, il pourrait être à l’origine de certains de nos comportements sociaux particuliers, ainsi que d’autres capacités mentales propres à l’être humain.
« Cette région du cerveau a une forte intensité métabolique; elle consomme beaucoup d’énergie », explique Bzdok.
« C’est aussi la région cérébrale qui reste malléable le plus longtemps au cours de notre développement, et nous savons maintenant que c’est aussi là que l’isolement social se fait sentir. C’est un aspect qui n’avait pas été signalé dans les études précédentes sur la solitude. »
L’analyse de vastes ensembles de données au moyen de l’IA pourrait accélérer la recherche sur de nombreux fronts. Par exemple, elle pourrait aider à repérer des facteurs de risque précédemment méconnus associés à des troubles comme la démence et la maladie d’Alzheimer, ou mettre en évidence des caractéristiques ou des traitements susceptibles de ralentir le déclin associé à ces troubles. Owen et son équipe donnent un autre exemple de l’utilisation des mégadonnées en neuroscience.
« L’année dernière, nous avons publié une étude dans laquelle nous avons examiné des données d’IRMf recueillies dix ans plus tôt. Il s’agissait de ce que l’on appelle des données sur l’état de repos de personnes dans le coma », explique-t-il.
« À l’époque, le mieux que nous pouvions faire était de comparer ces images à celles de personnes en bonne santé pour tenter de deviner lesquelles auraient le plus de chances de se rétablir. »
« Mais l’un de mes brillants étudiants diplômés a réussi à concevoir un algorithme d’apprentissage automatique pour accomplir cette tâche. Nous avons découvert que cet algorithme pouvait prédire avec une précision de 80 % qui se rétablirait et qui ne se rétablirait pas. Je pense que cela indique l’orientation que prend le domaine. »
Owen est optimiste quant au potentiel de l’IA et de l’apprentissage automatique pour aider les neuroscientifiques à donner un sens à leurs collections de données sans cesse croissantes. Mais il souligne aussi que le terme « intelligence artificielle » lui-même complique notre compréhension de la conscience.
« Pendant longtemps, les gens avaient recours à des concepts comme le test de Turing pour déterminer si une chose était consciente ou non », explique Owen.
« Or nous disposons aujourd’hui d’un grand nombre de systèmes d’IA qui réussissent le test de Turing avec brio. Et en même temps, la plupart des tout-petits ne seraient pas capables de le réussir. Certes, je ne pense pas qu’il faille accepter que les machines soient conscientes ou que les tout-petits ne le soient pas, mais je pense que cela montre la nécessité d’un nouveau test. »
Comme il est encore difficile de définir ce qu’est la conscience, les scientifiques qui cherchent à comprendre son origine se heurtent à des difficultés. Mais les avancées scientifiques réalisées par les membres du CIFAR témoignent de l’accélération des progrès grâce à des collaborations mondiales dans divers domaines comme la neuroscience, la psychologie et l’informatique.
En travaillant ensemble, nous pouvons non seulement aider les personnes qui en ont besoin, mais aussi approfondir notre compréhension de la nature humaine.
Articles liés
-
Microbiome humain : Modules d’enseignement pour les futur.es responsables du milieu de la santé
10 avril 2025
-
L’importance de la participation communautaire dans le déploiement de l’IA
31 mars 2025
-
Le CIFAR renouvelle ses programmes dans les domaines de l’IA, du développement de l’enfant et des matériaux quantiques
13 mars 2025
-
Richard Sutton remporte le prix Turing pour sa contribution majeure à l’IA
10 mars 2025